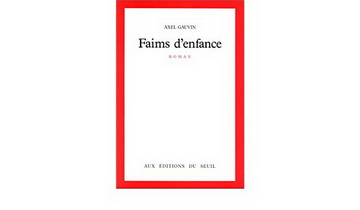Militant d’origine populaire, les deux parties de cette expression sont inséparables, et correspondent exactement à ce que Boudia a voulu être. Ce titre est un emprunt fait à un écrivain réunionnais Axel Gauvin, qui l’a donné à l’un de ses romans en 1987.
Il aurait pu être celui du premier roman très connu de Mohamed Dib paru en 1952 «La grande Maison», dont le jeune héros Omar âgé de 10 ans ne cesse d’être tenaillé par ce terrible manque dû au vide de son estomac. Et comme nombre d’enfants de son école sont aussi affamés que lui, la cour de l’école ressemble à une arène où ils se battent pour ramasser quelques croûtons. Se battent comme des chiens, telle est l’expression, et les plus forts prennent la part des plus petits. Nul n’oserait prétendre qu’il n’y a plus d’enfant dans le monde qui souffre de cette façon, bien que tous les rapports les plus sérieux donnent à penser que la faim, et sa forme collective la famine (qu’on pense à l’horreur qu’a connue le Biafra en 1967-70) est en régression. Est ou l’a été pendant dix années continûment, bien que depuis deux ans elle s’est remise à croître nous dit-on. Mais si la faim d’Omar nous revient à l’esprit aujourd’hui, c’est de manière un peu indirecte à travers l’histoire d’un personnage historique et non romanesque dont la vie et les œuvres nous sont très opportunément rappelées en cette année 2018, grâce au travail d’un valeureux éditeur qu’on ne saurait trop remercier. Les éditions dont il s’agit ont choisi de s’appeler Premiers matins de novembre», ce qui fait référence au début de la guerre d’indé- pendance de l’Algérie, inaugurée par l’appel du 1er Novembre 1954 ; de plus leur logo n’est autre que celui du drapeau algé- rien. Cependant elles ne sont pas installées en Algérie, mais à Toulouse en France et comme leur parti-pris est une grande discrétion on ne sait pas grand chose sur elles, sinon que tous les participants sont bénévoles. Quoi qu’il en soit on leur doit la parution récente d’un livre intitulé : «Mohamed Boudia, œuvres.
Ecrits politiques, théâtre, poésie et nouvelles». C’est peu de dire que ce livre n’avait jusque-là aucun équivalent, bien que Mohamed Boudia soit mort depuis juin 1973, dans le cadre des représailles exercées par le Mossad après la prise d’otages des Jeux Olympiques de Munich en septembre 1972. Tout cela est fort bien rappelé dans la précieuse et copieuse introduction du livre, destinée à évoquer le parcours plus historique que personnel de Mohamed Boudia. On laissera aux historiens le soin de revenir sur les faits, auxquels ce livre constitue un apport passionnant, et on s’attachera peut-être à quelques traits du personnage lui-même, qui est fascinant. Ne serait-ce que pour rappeler que c’est lui aussi un enfant de La Casbah et même plus précisément de cette partie de la haute-Casbah qu’est le quartier de Soustara exMontpensier. Ce quartier populaire où il est né en 1932 est un de ceux où les méfaits de la situation coloniale sont si visibles que la conscience politique et l’aspiration nationaliste y sont très développés. C’est dans ce creuset de révolte que se forme l’enfant Mohamed Boudia, petit cireur, vendeur de journaux, apprenti chez un tailleur juif. On n’a évidemment que très peu de témoignages sur la manière dont il a vécu dans ses annéeslà, sinon quelques traces de type autobiographique dans une nouvelle intitulée Les Oracles et parue en 1964 dans la revue Novembre. Mais on peut sûrement le rapprocher du jeune héros de Mohamed Dib, Omar , qui a dix ans en 1939 et qui vit dans une autre ville où la misère n’est pas moins grande, Tlemcen. Il serait bien étonnant que le jeune Mohamed Boudia n’ait pas lui aussi, comme Omar, connu la faim, et on en voit la preuve dans l’insatiable appétit qu’il manifeste plus tard, dans sa vie adulte, comme s’il s’agissait d’une compensation. Dans l’une des quatre préfaces au livre dont nous parlons, l’écrivain Djillali Bencheikh raconte de manière brillante une rencontre qu’il a eue avec Boudia au printemps 1973, c’est-à-dire quelques mois avant sa mort et à un moment où le moins qu’on puisse dire est qu’il y avait de quoi être préoccupé par la situation au Proche Orient. Djillali Bencheikh ne perd pas une miette (c’est le cas de le dire !) de ce qu’il entend et voit, tant la scène a pour lui quelque chose de sidérant. Et ce n’est pas pour rien s’il intitule sa préface L’enfant de Soustara faisant le rapport entre le yaouled un peu voyou de naguère et le personnage impressionnant que Boudia est devenu, Carrure de Lino Ventura et belle gueule à la Marlon Brando.
Mohamed Boudia, dont il célèbre le bon coup de fourchette, se régale ce jour-là chez des amis communs de brochettes de sardines accompagnées d’oignons blancs crus et bien craquants. Nul n’est mieux placé que le baroudeur propalestinien pour savoir l’imminence du danger -le mot est faible- et pourtant rien n’altère son bonheur de savourer l’exquise nourriture qui sans doute le faisait baver d’envie quand il était petit. Militant d’origine populaire, les deux parties de cette expression sont inséparables, et correspondent exactement à ce que Boudia a voulu être. Loin d’oublier qu’il a côtoyé les petits mendiants de La Casbah (mis en poésie par Aït Djafer), c’est parce qu’il s’en souvient au contraire que Boudia, devenu adulte et père, porte costume gris et pardessus blanc comme le rappelle son fils Rachid que cette élé- gance éblouissait. On voudrait poser sur sa tombe une grande assiette de sardines grillées, en grand amour et respect de l’homme qu’il a été.